
Sabre d’apparat en or et diamants du dernier roi de Pologne : Stanislas II Auguste Poniatowski, 1764-1795. COLLECTION PHILIPPE MISSILLIER, Étude Giquello, Drouot - salles 5-6, les 6 & 7 mars 2025
Vendu
COLLECTION PHILIPPE MISSILLIER
HAUTE ÉPOQUE – LIVRES – ARMES À FEU DU XVIIE SIÈCLE
ART CYNÉGÉTIQUE – PHALÉRISTIQUE
ARMES DES XVIIIE ET XIXE SIÈCLE – ART RUSSE
Vendredi 7 mars 2025 - 11h à 12h
AFRIQUE ET OCÉANIE – EXTRÊME-ORIENT
Vendredi 7 mars 2025 - 14h
ART ISLAMIQUE ET INDIEN
Drouot - salles 5-6
EXPOSITION
Mardi 4 mars de 11h à 18h
Mercredi 5 mars de 11h à 18h
Jeudi 6 mars de 11h à 12h
Téléphone pendant l’exposition + 33(0)1 48 00 20 05
GIQUELLO
Alexandre Giquello
Violette Stcherbatcheff
5, rue La Boétie - 75008 Paris
+33 (0)1 47 42 78 01 - info@giquello.net
o.v.v. agrément
n°2002 389
CONTACT
Claire Richon
+33(0)1 47 70 48 00
c.richon@giquello.net
EXPERT
Bertrand Malvaux, CNES
Lot n° 226 (de la vente)
Sabre d’apparat en or et diamants du dernier roi de Pologne : Stanislas II Auguste Poniatowski, 1764-1795.
Monture et toutes les garnitures du fourreau en or de quatre couleurs (jaune, rose, vert et blanc), garde enrichie de diamants.
Garde à une branche, caractéristique des unités de cavalerie légère de l’Europe du XVIIIème siècle. Branche de garde plate ciselée et ajourée d’une frise d’oves fleuronnés. L’angle droit de sa branche de garde et son important quillon avec enroulement sont appliqués de larges feuilles d’acanthe en or finement ciselé. Ses deux oreillons en or sont en forme de croix appliquée de part et d’autre de la garde droite ; l’extrémité des bras verticaux est ciselée d’un fleuron. Chaque oreillon porte en son centre un tondo à fond amati ciselé d’un motif en relief avec, sur la face externe, un buste de guerrier casqué et vêtu « à l’antique » (Mars) et, sur la face interne, un trophée d’arc et carquois sur rameaux de laurier. Deux diamants taillés en rose sont sertis de part et d’autre de la croisière horizontale de l'oreillon externe. Un diamant taillé en rose est serti dans un fleuron ciselé sur la partie supérieure du tondo interne. Sous la garde, est fixé un couvre-chape ovale en or à bordure guillochée qui s'emboîte par dessus le haut de la chape. Calotte en or à longue queue de forme arrondie, ciselée de feuillages en relief sur fond amati, dont les bordures sont finement gravées d’une moulure perlée. Poignée entièrement ciselée simulant un filigrane uni, bordé d’une branche de feuilles d’acanthe. Ses deux faces sont ornées d’une grande réserve ovale, décorée en relief sur fond or amati d’un trophée d’armes : armure, casque empanaché et faisceau de drapeaux, sur la face externe ; bouclier, glaive et faisceau de drapeaux sur la face interne.
Lame européenne en acier damas, légèrement courbe, à dos plat et gorges. Elle porte des inscriptions en or sur le pan creux droit. Au talon, se lisant pointe vers le haut, est incrusté le monogramme royal sous couronne : S A (Stanislas Augustus). Se lisant du talon à la pointe, tranchant vers le haut, une inscription en caractères cursifs arabes est incrustée d’or en relief : cet adage (la tashabni illa fi mahall al-darur[a] wa la taj'alni fi makani illa b'il-'izz wa'l-takrim) peut se traduire ainsi en français par « Ne me dégaine pas sans raison, ne me rengaine pas sans gloire ni honneur ».
Fourreau en bois recouvert de chagrin noir. Il porte trois garnitures en or très finement découpées à jour et finement ciselées d’un décor symétrique sur ses deux faces et « en suite » avec la décoration de la poignée. Des réserves rectangulaires à angles échancrés sont ciselées en relief de trophées militaires sur fond amati. La chape et le bracelet
portent chacun un anneau de bélière facetté en or. La longue bouterolle, avec un dard en bouton, est largement ajourée et présente, à son extrémité inférieure, une large coquille.
Pologne, vers 1770-1775.
Poinçon au hibou sur la poignée et en partie haute du fourreau.
Longueur : 96 cm.
Poids brut : 1092 gr.
Pologne.
XVIIIème siècle, vers 1770-1775.
Parfait état.
500000/700000
Provenance : Si Stanislas-Auguste engendra plusieurs enfants naturels, il ne fut jamais marié et n’eut, par conséquent, aucun descendant légal comme héritier direct avant son décès, le 12 février 1798. Selon la monarchie élective polonaise, les héritiers du roi recevaient les biens personnels du défunt. Ainsi, le légataire universel de Stanislas II Auguste fut son
neveu, le prince Józef Antoni Poniatowski (1763-1813). Józef offrit un sabre à Napoléon, donna le second à la famille Wodziński (comme nous allons le détailler plus loin), il garda très probablement le troisième exemplaire pour lui.
Józef Antoni ne put mener à terme la liquidation de tout l’héritage avant son décès, lors de la bataille de Leipzig, le 19 octobre 1813. Ses biens revinrent alors à sa soeur Maria Teresa Poniatowska Tyszkiewiczowa (1760-1834) qui vivait en France, depuis 1807, et était la maîtresse de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838), prince de Bénévent. En novembre 1813, Maria Teresa donna procuration à Aleksander Linowski, l’exécuteur testamentaire de feu son frère, pour liquider son héritage. Entre 1814 et 1819, des biens de Stanislas-Auguste furent vendus aux enchères. En 1817, Maria Teresa vendit au Tsar Alexandre Ier le palais Łazienki à Varsovie avec son entier mobilier. Le reliquat des biens provenant de l’ancien roi de Pologne fut acheté, en 1821, par Antonio Fusi de Milan.
Maria Teresa décéda à Tours, en 1834.
— Stanislas II Auguste, le dernier roi de Pologne (r. 1764-1795), vers 1770-1775,
— Prince Józef Antoni Poniatowski, neveu du roi, par héritage en 1798,
— Maria Teresa Poniatowska Tyszkiewiczowa, soeur du prince, par héritage en 1813,
— Probablement Antonio Fusi, joaillier à Milan, en 1821,
— Sapjo, antiquaire - joaillier à Monte-Carlo (principauté de Monaco), avant 1990,
— Collection particulière, par acquisition du précédent à la Biennale des Antiquaires de Paris de 1990,
— Collection Philippe Missillier.
Note : Le catalogue de la XVe Biennale Internationale de Paris en 1990 présentait le sabre sur deux pages par l’antiquaire et joaillier Mr Sapjo, et mentionnait par erreur la provenance « Ancienne collection Jean-Jacques Reubell ». Si ce sabre est extrêmement proche des descriptifs du « sabre Reubell », il ne comporte cependant pas les deux anneaux latéraux de garde, ni les deux armoiries et noms polonais gravés, ni de lame en acier damas, mentionnés dans les descriptifs de 1933 et 1964.
L’orfèvre présumé des trois sabres d’apparat en or du roi Stanislas II Auguste.
L’examen des descriptions et l'observation des images de ces trois sabres permettent de penser que tous trois furent réalisés par le même orfèvre.
L'orfèvre de ces trois précieux sabres en or est très certainement Joachim Friedrich Jacobson, dit être actif à Varsovie de 1750 à 1776, qui réalisa des commandes pour le roi Stanislas II Auguste et sa cour. Jacobson fut l’auteur, en 1764, du fameux glaive de l’ordre de l’Aigle Blanc, dessiné par l’architecte polonais Efraïm Schröger (1727-1783), et conservé au musée du Château royal de Varsovie (inv. ZKW 1251/a, b). Stanislas II Auguste fut peint en habit du couronnement portant ce glaive. Jacobson fut également l’auteur de colliers de l’ordre royal de l’Aigle Blanc de Pologne .
Biographie : Quatrième fils du comte Stanislas Poniatowski (1676-1762), castellan de Cracovie issu de la plus haute noblesse polonaise, et de la princesse Constance Czartoryska, Stanislas-Auguste naquit, le 17 janvier 1732, à Wołczyn.
Dès 1748, il commença à voyager et se rendit en Allemagne, Pays-Bas, Autriche. En 1752, son père lui acheta le titre de staroste de Przemyśl qui lui permit d’entrer au parlement. En 1753, il reprit ses voyages en Hongrie, Autriche, Pays-Bas, Paris (où il fréquenta l’élite intellectuelle), et Londres. En 1754, il rentra en Pologne et reçut le titre de Panetier de Lituanie (stolnik litewski). En 1755, il fut envoyé en Russie pour servir auprès de son mentor et ami, Sir Charles Hanbury Williams (1708-1759), nommé ambassadeur de Grande-Bretagne à Saint-Pétersbourg. Ce fut là que Stanislas-Auguste fut présenté à la grande-duchesse et altesse impériale Catherine Alexeïevna (1729-1796), épouse du prince héritier Pierre Fedorovitch (1728-1762), mère de Paul Petrovitch (1754-1801), et future Catherine II de Russie.
Une relation passionnée et mouvementée s’ensuivit. En raison d’intrigues de cour à son encontre, Stanislas-Auguste dut quitter Saint-Pétersbourg en 1758. De retour en Pologne, il s’engagea dans une politique pro-russe et anti-prussienne.
Le roi Auguste III de Pologne décéda en octobre 1763, et Stanislas-Auguste Poniatowski se présenta à l’élection de nouveau roi de la République nobiliaire des Deux Nations. Soutenu financièrement et militairement par l'impératrice Catherine II, il fut élu le 7 septembre 1764 et couronné le 25 novembre. Ainsi il était, par la grâce de Dieu et la volonté du peuple, roi de Pologne, grand-duc de Lituanie et duc de Ruthénie, Prusse, Mazovie, Samogitie, Kiev, Volhynie, Podolie, Podlaskie, Livonie, Smolensk, Sievers et Tchernihiv. Stanislas II Auguste voulut aussitôt réformer le gouvernement en réduisant les pouvoirs des hauts commandants militaires (hetmans) et des trésoriers, instaurer une politique de défense des minorités religieuses, et surtout supprimer la règle de l’unanimité (liberum veto) qui limitait trop les décisions de la chambre délibérative. Il se heurta à une forte résistance, instiguée par la Russie qui voulait garder sous sa tutelle une Pologne-Lituanie faible. L’ingérence russe dans les affaires polonaises provoqua une insurrection, la Confédération de Bar, dirigée contre le roi soutenu par Catherine II, et qui tourna en une longue guerre civile, de 1768 à 1772. La Confédération proclama la destitution de Stanislas II Auguste, en 1771, mais elle dut déposer les armes en 1772, écrasée par les troupes russes. Ce fut l’occasion pour la Russie et ses alliés, le royaume de Prusse et l’empire d’Autriche, de procéder à un partage partiel de la Pologne.
Le roi perdit le droit de donner des titres et de nommer les officiers militaires, ainsi que les ministres et les sénateurs. Les terres de la Couronne furent vendues aux enchères. Toutefois Stanislas II Auguste réussit à se maintenir sur le trône et, dès 1776, demanda la rédaction d’un code civil.
Le 3 mai 1791, il promulgua une des premières constitutions d’Europe, puis demanda à nouveau l’élaboration d’un code civil et pénal. La noblesse polonaise, y voyant une menace à ses privilèges, décida de renverser la Constitution, se souleva en formant la Confédération de Targowica et demanda l’aide de la Russie. En 1792, la supériorité numérique militaire russe étant trop grande, Stanislas II Auguste décida la reddition. L’armée polonaise fut dissoute, la constitution annulée et un second partage de la Pologne effectué.
En 1794, il soutint l’insurrection de Kościuszko contre la Russie, mais ce fut une cuisante défaite infligée par le général russe Alexandre Souvorov qui occupa Varsovie. L’impératrice Catherine II ordonna à Stanislas II Auguste de quitter sa capitale pour se rendre à Grodno sous escorte militaire russe. En 1795, la Pologne subit un troisième partage qui provoqua la disparition du royaume. L’Autriche prit le contrôle de la Galicie et la région de Cracovie, la Prusse celui de la Posnanie et la région de Varsovie, et la Russie celui du Grand-duché de Lituanie. Le roi Stanislas II Auguste fut contraint d’abdiquer, le 25 novembre 1795.
Catherine II mourut en novembre 1796 et son fils, Paul I (r. 1796-1801), lui succéda. Sommé de se rendre à Saint-Pétersbourg, Stanislas-Auguste quitta Grodno, le 15 février 1797. Il lui fut alloué une prison virtuelle, le Palais de Marbre, où avait vécu le comte Grigori Orlov, un autre favori de la Grande Catherine. Stanislas-Auguste Poniatowski y décéda, le 12 février 1798.
Exemplaires connus : Trois sabres d'apparat en or du roi Stanislas II Auguste Poniatowski (r. 1764-1795) sont actuellement connus.
-1- Un sabre d’apparat en or émaillé du roi Stanislas II Auguste, appartient aux collections du musée de l’Armée, Hôtel des Invalides à Paris.
Monture en or émaillé bleu nuit et blanc, avec inserts de diamants. Garde à une branche d’un type spécifique à la Pologne, comportant deux anneaux latéraux fixés de part et d’autre de la croisière droite horizontale. Calotte à longue queue, sommet avec réserve ovale dans laquelle est serti un monogramme en diamants taillés en rose : S. A. R. entrelacés (Stanislas Augustus Rex). Chaque oreillon porte en son centre un tondo, à fond émaillé bleu nuit, peint d’un portrait émaillé en grisaille de « Minerve » sur la face externe, et de « Mars », sur la face interne. La lame droite, à dos plat, en acier damas avec de part et d’autre un décor en or : pan gauche damasquiné or de caractères arabes cursifs ; pan droit incrusté en or du profil droit du roi Étienne Báthory, au talon, puis de l’inscription en capitales latines « STEPHANUS .BATOREUS . REX . POLONIAE . A[nno] . D[omini] . 1575 ». Fourreau droit, en bois recouvert de chagrin noir, à trois garnitures en or, découpées à jour et finement ciselées, à décor émaillé « en suite » avec la poignée. Ce sabre est communément attribué à la Pologne et daté vers 1780.
Hérité du roi Stanislas II Auguste, ce précieux sabre fut offert par le prince Józef Antoni Poniatowski à l’Empereur Napoléon Ier, lors de son séjour à Varsovie en janvier 1807, alors qu’il résidait dans le château royal, réaménagé par le dernier souverain de Pologne.
À Sainte-Hélène, Napoléon selon son testament olographe, rédigé le 15 avril 1821, Napoléon léguait ce sabre à son fils né en 1811, ancien roi de Rome (1814-1818). Le comte Henri-Gatien Bertrand (1773-1844), ancien Grand maréchal du palais de l'Empereur, était chargé de le lui remettre pour ses seize ans, le 20 mars 1827. Le fils de Napoléon Ier mourut prématurément le 22 juillet 1832. Le sabre fut par conséquent attribué à Jérôme Bonaparte (1784-1860), le plus jeune frère de l’Empereur et roi de Westphalie de 1807 à 1813, qui le donna à son fils, le prince Napoléon-Jérôme (1822-1891), en 1840. Puis le sabre fut acquis par un autre neveu de l’Empereur, Louis-Napoléon (1808-1873), alors prince-président avant de devenir empereur des Français, sous le titre de Napoléon III.
Le 15 février 1850, il remit le sabre au musée de l’Artillerie de Paris, aujourd’hui musée de l’Armée, dont un catalogue fut publié en 1862 par Octave Penguilly L’Haridon sous le N° J 92.
-2- Le sabre d’apparat en or de plusieurs couleurs du roi Stanislas II Auguste, de l’ancienne collection Jean-Jacques Reubell (1861-1933) à Paris.
Ce sabre nous est principalement connu par le catalogue de la vente aux enchères de sa collection, dispersée à titre posthume et dirigée par Maîtres Henri Baudouin et Étienne Ader (commissaires-priseurs), le 12 décembre 1933, à l’Hôtel Drouot de Paris. Sous le lot 175 page 34, l’expert Henri Leman le décrivait ainsi : « Sabre à monture et garnitures en or ciselé, la poignée est ornée de médaillons feuillagés en or de couleurs, représentant des trophées d’armes et de drapeaux. Sur les oreillons un buste d’homme casqué et un trophée avec arc et carquois. Garde à branche et à deux anneaux avec sous le poucier deux écussons d’armoiries gravés et le nom de Maltzan Wodzinski. Fourreau en maroquin noir avec garnitures en or ciselé à décor de trophées. Lame courbe, gravée d’inscriptions orientales dorées et du chiffre S.A. timbré d’une couronne royale : Stanislas Auguste, roi de Pologne. Fin du XVIIIe siècle. Long., 98 cent. »
Le 6 décembre 1964, Robert-Jean Charles (1904-1979), expert parisien, établit un descriptif plus élaboré de ce sabre vraisemblablement à la demande du propriétaire de l’époque : « Sabre de Stanislas II Auguste – Roi de Pologne (1732+1798) Roi de 1764 à 1795 ». Le second descriptif de ce sabre diffère de celui de la vente de 1933 par l’absence de la mention des deux armoiries et noms polonais gravés. Robert-Jean Charles devait considérer ces additions postérieures comme sans lien historique avec ce sabre.
Les armoiries doubles et deux noms polonais gravés, Maltzan et Wodziński gravés postérieurement sur la lame probablement par le récipiendaire ou sa famille, bien après le décès du roi en 1798. Le général d'armée Ignacy Wodziński (1745-1815) était aide de camp de Stanislas II Auguste, depuis 1777, et un ami proche. Il se proposa de rester auprès du roi déchu, pendant la durée de son exil à Grodno (décembre 1794 - février 1797).
Ce sabre a donc, soit été donné comme présent, avant 1798, de Stanislas II Auguste au général pour services rendus à sa personne ; ou bien, le sabre a été donné en cadeau, entre 1798 et 1813, du prince Józef Antoni Poniatowski au général Wodziński, en reconnaissance de sa dévotion et fidélité au roi. Le général et le prince s'étaient ralliés à l’insurrection de Kościuszko soutenue par le roi. Izabela Wodzińska épousa le baron von Maltzan en 1807, et hérita du précieux sabre en or de son père, en 1815. Elle immortalisa l’attachement de sa famille à l’ancien roi en y faisant graver ses armoiries conjugales et noms, Maltzan Wodziński.
Les circonstances de l'acquisition de ce sabre par Jean-Jacques Reubell sont ignorées.
L’exemplaire du catalogue de la vente Reubell (Drouot les 11 et 12 décembre 1966, salle 11, n° 175) provenant de Robert-Jean Charles porte, en regard des lots, des notes manuscrites dont le montant des adjudications et le nom de certains adjudicataires, le nom « Bacri » et l’appréciation « pièce d’orfèvrerie » sont écrites pour ce lot. Jacques Bacri (1911-1965) fut l'un des plus grands collectionneurs et marchands d'art du milieu du XXème siècle, puis antiquaire à Paris.
-3- Le troisième exemplaire est ici présenté.
HAUTE ÉPOQUE – LIVRES – ARMES À FEU DU XVIIE SIÈCLE
ART CYNÉGÉTIQUE – PHALÉRISTIQUE
ARMES DES XVIIIE ET XIXE SIÈCLE – ART RUSSE
Vendredi 7 mars 2025 - 11h à 12h
AFRIQUE ET OCÉANIE – EXTRÊME-ORIENT
Vendredi 7 mars 2025 - 14h
ART ISLAMIQUE ET INDIEN
Drouot - salles 5-6
EXPOSITION
Mardi 4 mars de 11h à 18h
Mercredi 5 mars de 11h à 18h
Jeudi 6 mars de 11h à 12h
Téléphone pendant l’exposition + 33(0)1 48 00 20 05
GIQUELLO
Alexandre Giquello
Violette Stcherbatcheff
5, rue La Boétie - 75008 Paris
+33 (0)1 47 42 78 01 - info@giquello.net
o.v.v. agrément
n°2002 389
CONTACT
Claire Richon
+33(0)1 47 70 48 00
c.richon@giquello.net
EXPERT
Bertrand Malvaux, CNES
Lot n° 226 (de la vente)
Sabre d’apparat en or et diamants du dernier roi de Pologne : Stanislas II Auguste Poniatowski, 1764-1795.
Monture et toutes les garnitures du fourreau en or de quatre couleurs (jaune, rose, vert et blanc), garde enrichie de diamants.
Garde à une branche, caractéristique des unités de cavalerie légère de l’Europe du XVIIIème siècle. Branche de garde plate ciselée et ajourée d’une frise d’oves fleuronnés. L’angle droit de sa branche de garde et son important quillon avec enroulement sont appliqués de larges feuilles d’acanthe en or finement ciselé. Ses deux oreillons en or sont en forme de croix appliquée de part et d’autre de la garde droite ; l’extrémité des bras verticaux est ciselée d’un fleuron. Chaque oreillon porte en son centre un tondo à fond amati ciselé d’un motif en relief avec, sur la face externe, un buste de guerrier casqué et vêtu « à l’antique » (Mars) et, sur la face interne, un trophée d’arc et carquois sur rameaux de laurier. Deux diamants taillés en rose sont sertis de part et d’autre de la croisière horizontale de l'oreillon externe. Un diamant taillé en rose est serti dans un fleuron ciselé sur la partie supérieure du tondo interne. Sous la garde, est fixé un couvre-chape ovale en or à bordure guillochée qui s'emboîte par dessus le haut de la chape. Calotte en or à longue queue de forme arrondie, ciselée de feuillages en relief sur fond amati, dont les bordures sont finement gravées d’une moulure perlée. Poignée entièrement ciselée simulant un filigrane uni, bordé d’une branche de feuilles d’acanthe. Ses deux faces sont ornées d’une grande réserve ovale, décorée en relief sur fond or amati d’un trophée d’armes : armure, casque empanaché et faisceau de drapeaux, sur la face externe ; bouclier, glaive et faisceau de drapeaux sur la face interne.
Lame européenne en acier damas, légèrement courbe, à dos plat et gorges. Elle porte des inscriptions en or sur le pan creux droit. Au talon, se lisant pointe vers le haut, est incrusté le monogramme royal sous couronne : S A (Stanislas Augustus). Se lisant du talon à la pointe, tranchant vers le haut, une inscription en caractères cursifs arabes est incrustée d’or en relief : cet adage (la tashabni illa fi mahall al-darur[a] wa la taj'alni fi makani illa b'il-'izz wa'l-takrim) peut se traduire ainsi en français par « Ne me dégaine pas sans raison, ne me rengaine pas sans gloire ni honneur ».
Fourreau en bois recouvert de chagrin noir. Il porte trois garnitures en or très finement découpées à jour et finement ciselées d’un décor symétrique sur ses deux faces et « en suite » avec la décoration de la poignée. Des réserves rectangulaires à angles échancrés sont ciselées en relief de trophées militaires sur fond amati. La chape et le bracelet
portent chacun un anneau de bélière facetté en or. La longue bouterolle, avec un dard en bouton, est largement ajourée et présente, à son extrémité inférieure, une large coquille.
Pologne, vers 1770-1775.
Poinçon au hibou sur la poignée et en partie haute du fourreau.
Longueur : 96 cm.
Poids brut : 1092 gr.
Pologne.
XVIIIème siècle, vers 1770-1775.
Parfait état.
500000/700000
Provenance : Si Stanislas-Auguste engendra plusieurs enfants naturels, il ne fut jamais marié et n’eut, par conséquent, aucun descendant légal comme héritier direct avant son décès, le 12 février 1798. Selon la monarchie élective polonaise, les héritiers du roi recevaient les biens personnels du défunt. Ainsi, le légataire universel de Stanislas II Auguste fut son
neveu, le prince Józef Antoni Poniatowski (1763-1813). Józef offrit un sabre à Napoléon, donna le second à la famille Wodziński (comme nous allons le détailler plus loin), il garda très probablement le troisième exemplaire pour lui.
Józef Antoni ne put mener à terme la liquidation de tout l’héritage avant son décès, lors de la bataille de Leipzig, le 19 octobre 1813. Ses biens revinrent alors à sa soeur Maria Teresa Poniatowska Tyszkiewiczowa (1760-1834) qui vivait en France, depuis 1807, et était la maîtresse de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838), prince de Bénévent. En novembre 1813, Maria Teresa donna procuration à Aleksander Linowski, l’exécuteur testamentaire de feu son frère, pour liquider son héritage. Entre 1814 et 1819, des biens de Stanislas-Auguste furent vendus aux enchères. En 1817, Maria Teresa vendit au Tsar Alexandre Ier le palais Łazienki à Varsovie avec son entier mobilier. Le reliquat des biens provenant de l’ancien roi de Pologne fut acheté, en 1821, par Antonio Fusi de Milan.
Maria Teresa décéda à Tours, en 1834.
— Stanislas II Auguste, le dernier roi de Pologne (r. 1764-1795), vers 1770-1775,
— Prince Józef Antoni Poniatowski, neveu du roi, par héritage en 1798,
— Maria Teresa Poniatowska Tyszkiewiczowa, soeur du prince, par héritage en 1813,
— Probablement Antonio Fusi, joaillier à Milan, en 1821,
— Sapjo, antiquaire - joaillier à Monte-Carlo (principauté de Monaco), avant 1990,
— Collection particulière, par acquisition du précédent à la Biennale des Antiquaires de Paris de 1990,
— Collection Philippe Missillier.
Note : Le catalogue de la XVe Biennale Internationale de Paris en 1990 présentait le sabre sur deux pages par l’antiquaire et joaillier Mr Sapjo, et mentionnait par erreur la provenance « Ancienne collection Jean-Jacques Reubell ». Si ce sabre est extrêmement proche des descriptifs du « sabre Reubell », il ne comporte cependant pas les deux anneaux latéraux de garde, ni les deux armoiries et noms polonais gravés, ni de lame en acier damas, mentionnés dans les descriptifs de 1933 et 1964.
L’orfèvre présumé des trois sabres d’apparat en or du roi Stanislas II Auguste.
L’examen des descriptions et l'observation des images de ces trois sabres permettent de penser que tous trois furent réalisés par le même orfèvre.
L'orfèvre de ces trois précieux sabres en or est très certainement Joachim Friedrich Jacobson, dit être actif à Varsovie de 1750 à 1776, qui réalisa des commandes pour le roi Stanislas II Auguste et sa cour. Jacobson fut l’auteur, en 1764, du fameux glaive de l’ordre de l’Aigle Blanc, dessiné par l’architecte polonais Efraïm Schröger (1727-1783), et conservé au musée du Château royal de Varsovie (inv. ZKW 1251/a, b). Stanislas II Auguste fut peint en habit du couronnement portant ce glaive. Jacobson fut également l’auteur de colliers de l’ordre royal de l’Aigle Blanc de Pologne .
Biographie : Quatrième fils du comte Stanislas Poniatowski (1676-1762), castellan de Cracovie issu de la plus haute noblesse polonaise, et de la princesse Constance Czartoryska, Stanislas-Auguste naquit, le 17 janvier 1732, à Wołczyn.
Dès 1748, il commença à voyager et se rendit en Allemagne, Pays-Bas, Autriche. En 1752, son père lui acheta le titre de staroste de Przemyśl qui lui permit d’entrer au parlement. En 1753, il reprit ses voyages en Hongrie, Autriche, Pays-Bas, Paris (où il fréquenta l’élite intellectuelle), et Londres. En 1754, il rentra en Pologne et reçut le titre de Panetier de Lituanie (stolnik litewski). En 1755, il fut envoyé en Russie pour servir auprès de son mentor et ami, Sir Charles Hanbury Williams (1708-1759), nommé ambassadeur de Grande-Bretagne à Saint-Pétersbourg. Ce fut là que Stanislas-Auguste fut présenté à la grande-duchesse et altesse impériale Catherine Alexeïevna (1729-1796), épouse du prince héritier Pierre Fedorovitch (1728-1762), mère de Paul Petrovitch (1754-1801), et future Catherine II de Russie.
Une relation passionnée et mouvementée s’ensuivit. En raison d’intrigues de cour à son encontre, Stanislas-Auguste dut quitter Saint-Pétersbourg en 1758. De retour en Pologne, il s’engagea dans une politique pro-russe et anti-prussienne.
Le roi Auguste III de Pologne décéda en octobre 1763, et Stanislas-Auguste Poniatowski se présenta à l’élection de nouveau roi de la République nobiliaire des Deux Nations. Soutenu financièrement et militairement par l'impératrice Catherine II, il fut élu le 7 septembre 1764 et couronné le 25 novembre. Ainsi il était, par la grâce de Dieu et la volonté du peuple, roi de Pologne, grand-duc de Lituanie et duc de Ruthénie, Prusse, Mazovie, Samogitie, Kiev, Volhynie, Podolie, Podlaskie, Livonie, Smolensk, Sievers et Tchernihiv. Stanislas II Auguste voulut aussitôt réformer le gouvernement en réduisant les pouvoirs des hauts commandants militaires (hetmans) et des trésoriers, instaurer une politique de défense des minorités religieuses, et surtout supprimer la règle de l’unanimité (liberum veto) qui limitait trop les décisions de la chambre délibérative. Il se heurta à une forte résistance, instiguée par la Russie qui voulait garder sous sa tutelle une Pologne-Lituanie faible. L’ingérence russe dans les affaires polonaises provoqua une insurrection, la Confédération de Bar, dirigée contre le roi soutenu par Catherine II, et qui tourna en une longue guerre civile, de 1768 à 1772. La Confédération proclama la destitution de Stanislas II Auguste, en 1771, mais elle dut déposer les armes en 1772, écrasée par les troupes russes. Ce fut l’occasion pour la Russie et ses alliés, le royaume de Prusse et l’empire d’Autriche, de procéder à un partage partiel de la Pologne.
Le roi perdit le droit de donner des titres et de nommer les officiers militaires, ainsi que les ministres et les sénateurs. Les terres de la Couronne furent vendues aux enchères. Toutefois Stanislas II Auguste réussit à se maintenir sur le trône et, dès 1776, demanda la rédaction d’un code civil.
Le 3 mai 1791, il promulgua une des premières constitutions d’Europe, puis demanda à nouveau l’élaboration d’un code civil et pénal. La noblesse polonaise, y voyant une menace à ses privilèges, décida de renverser la Constitution, se souleva en formant la Confédération de Targowica et demanda l’aide de la Russie. En 1792, la supériorité numérique militaire russe étant trop grande, Stanislas II Auguste décida la reddition. L’armée polonaise fut dissoute, la constitution annulée et un second partage de la Pologne effectué.
En 1794, il soutint l’insurrection de Kościuszko contre la Russie, mais ce fut une cuisante défaite infligée par le général russe Alexandre Souvorov qui occupa Varsovie. L’impératrice Catherine II ordonna à Stanislas II Auguste de quitter sa capitale pour se rendre à Grodno sous escorte militaire russe. En 1795, la Pologne subit un troisième partage qui provoqua la disparition du royaume. L’Autriche prit le contrôle de la Galicie et la région de Cracovie, la Prusse celui de la Posnanie et la région de Varsovie, et la Russie celui du Grand-duché de Lituanie. Le roi Stanislas II Auguste fut contraint d’abdiquer, le 25 novembre 1795.
Catherine II mourut en novembre 1796 et son fils, Paul I (r. 1796-1801), lui succéda. Sommé de se rendre à Saint-Pétersbourg, Stanislas-Auguste quitta Grodno, le 15 février 1797. Il lui fut alloué une prison virtuelle, le Palais de Marbre, où avait vécu le comte Grigori Orlov, un autre favori de la Grande Catherine. Stanislas-Auguste Poniatowski y décéda, le 12 février 1798.
Exemplaires connus : Trois sabres d'apparat en or du roi Stanislas II Auguste Poniatowski (r. 1764-1795) sont actuellement connus.
-1- Un sabre d’apparat en or émaillé du roi Stanislas II Auguste, appartient aux collections du musée de l’Armée, Hôtel des Invalides à Paris.
Monture en or émaillé bleu nuit et blanc, avec inserts de diamants. Garde à une branche d’un type spécifique à la Pologne, comportant deux anneaux latéraux fixés de part et d’autre de la croisière droite horizontale. Calotte à longue queue, sommet avec réserve ovale dans laquelle est serti un monogramme en diamants taillés en rose : S. A. R. entrelacés (Stanislas Augustus Rex). Chaque oreillon porte en son centre un tondo, à fond émaillé bleu nuit, peint d’un portrait émaillé en grisaille de « Minerve » sur la face externe, et de « Mars », sur la face interne. La lame droite, à dos plat, en acier damas avec de part et d’autre un décor en or : pan gauche damasquiné or de caractères arabes cursifs ; pan droit incrusté en or du profil droit du roi Étienne Báthory, au talon, puis de l’inscription en capitales latines « STEPHANUS .BATOREUS . REX . POLONIAE . A[nno] . D[omini] . 1575 ». Fourreau droit, en bois recouvert de chagrin noir, à trois garnitures en or, découpées à jour et finement ciselées, à décor émaillé « en suite » avec la poignée. Ce sabre est communément attribué à la Pologne et daté vers 1780.
Hérité du roi Stanislas II Auguste, ce précieux sabre fut offert par le prince Józef Antoni Poniatowski à l’Empereur Napoléon Ier, lors de son séjour à Varsovie en janvier 1807, alors qu’il résidait dans le château royal, réaménagé par le dernier souverain de Pologne.
À Sainte-Hélène, Napoléon selon son testament olographe, rédigé le 15 avril 1821, Napoléon léguait ce sabre à son fils né en 1811, ancien roi de Rome (1814-1818). Le comte Henri-Gatien Bertrand (1773-1844), ancien Grand maréchal du palais de l'Empereur, était chargé de le lui remettre pour ses seize ans, le 20 mars 1827. Le fils de Napoléon Ier mourut prématurément le 22 juillet 1832. Le sabre fut par conséquent attribué à Jérôme Bonaparte (1784-1860), le plus jeune frère de l’Empereur et roi de Westphalie de 1807 à 1813, qui le donna à son fils, le prince Napoléon-Jérôme (1822-1891), en 1840. Puis le sabre fut acquis par un autre neveu de l’Empereur, Louis-Napoléon (1808-1873), alors prince-président avant de devenir empereur des Français, sous le titre de Napoléon III.
Le 15 février 1850, il remit le sabre au musée de l’Artillerie de Paris, aujourd’hui musée de l’Armée, dont un catalogue fut publié en 1862 par Octave Penguilly L’Haridon sous le N° J 92.
-2- Le sabre d’apparat en or de plusieurs couleurs du roi Stanislas II Auguste, de l’ancienne collection Jean-Jacques Reubell (1861-1933) à Paris.
Ce sabre nous est principalement connu par le catalogue de la vente aux enchères de sa collection, dispersée à titre posthume et dirigée par Maîtres Henri Baudouin et Étienne Ader (commissaires-priseurs), le 12 décembre 1933, à l’Hôtel Drouot de Paris. Sous le lot 175 page 34, l’expert Henri Leman le décrivait ainsi : « Sabre à monture et garnitures en or ciselé, la poignée est ornée de médaillons feuillagés en or de couleurs, représentant des trophées d’armes et de drapeaux. Sur les oreillons un buste d’homme casqué et un trophée avec arc et carquois. Garde à branche et à deux anneaux avec sous le poucier deux écussons d’armoiries gravés et le nom de Maltzan Wodzinski. Fourreau en maroquin noir avec garnitures en or ciselé à décor de trophées. Lame courbe, gravée d’inscriptions orientales dorées et du chiffre S.A. timbré d’une couronne royale : Stanislas Auguste, roi de Pologne. Fin du XVIIIe siècle. Long., 98 cent. »
Le 6 décembre 1964, Robert-Jean Charles (1904-1979), expert parisien, établit un descriptif plus élaboré de ce sabre vraisemblablement à la demande du propriétaire de l’époque : « Sabre de Stanislas II Auguste – Roi de Pologne (1732+1798) Roi de 1764 à 1795 ». Le second descriptif de ce sabre diffère de celui de la vente de 1933 par l’absence de la mention des deux armoiries et noms polonais gravés. Robert-Jean Charles devait considérer ces additions postérieures comme sans lien historique avec ce sabre.
Les armoiries doubles et deux noms polonais gravés, Maltzan et Wodziński gravés postérieurement sur la lame probablement par le récipiendaire ou sa famille, bien après le décès du roi en 1798. Le général d'armée Ignacy Wodziński (1745-1815) était aide de camp de Stanislas II Auguste, depuis 1777, et un ami proche. Il se proposa de rester auprès du roi déchu, pendant la durée de son exil à Grodno (décembre 1794 - février 1797).
Ce sabre a donc, soit été donné comme présent, avant 1798, de Stanislas II Auguste au général pour services rendus à sa personne ; ou bien, le sabre a été donné en cadeau, entre 1798 et 1813, du prince Józef Antoni Poniatowski au général Wodziński, en reconnaissance de sa dévotion et fidélité au roi. Le général et le prince s'étaient ralliés à l’insurrection de Kościuszko soutenue par le roi. Izabela Wodzińska épousa le baron von Maltzan en 1807, et hérita du précieux sabre en or de son père, en 1815. Elle immortalisa l’attachement de sa famille à l’ancien roi en y faisant graver ses armoiries conjugales et noms, Maltzan Wodziński.
Les circonstances de l'acquisition de ce sabre par Jean-Jacques Reubell sont ignorées.
L’exemplaire du catalogue de la vente Reubell (Drouot les 11 et 12 décembre 1966, salle 11, n° 175) provenant de Robert-Jean Charles porte, en regard des lots, des notes manuscrites dont le montant des adjudications et le nom de certains adjudicataires, le nom « Bacri » et l’appréciation « pièce d’orfèvrerie » sont écrites pour ce lot. Jacques Bacri (1911-1965) fut l'un des plus grands collectionneurs et marchands d'art du milieu du XXème siècle, puis antiquaire à Paris.
-3- Le troisième exemplaire est ici présenté.
Référence :
Étude Giquello, Drouot - salles 5-6, les 6 & 7 mars 2025
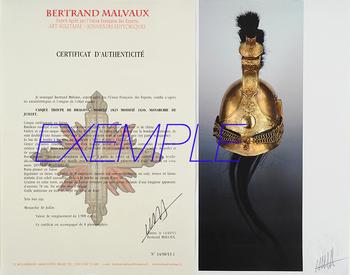
Prochaine mise à jour vendredi 4 avril à 13H30
POUR TOUT ACHAT, PAIEMENT EN PLUSIEURS CHÈQUES POSSIBLE
bertrand.malvaux@wanadoo.fr 06 07 75 74 63
FRAIS DE PORT
Les frais de port ne sont calculés qu'une seule fois par commande pour un ou plusieurs objets, les envois sont tous recommandés, car c'est le seul moyen d'avoir une preuve de l'envoi et de la réception.
Pour les colis dont la valeur ne peut être assurée par la Poste, les envois sont confiés à la société DHL ou Fedex avec valeur réelle assurée, le service est de qualité mais le coût est plus élevé.
DROIT DE RETOUR
Les objets peuvent être retournés dans un délai de 8 jours après leur réception. Il faut les retourner en recommandé aux frais de l'expéditeur, dans leur emballage d'origine, et dans leur état d'origine,
AUTHENTICITÉ
La sélection des objets proposés sur ce site me permet de garantir l'authenticité de chacune des pièces qui y sont décrites, tous les objets proposés sont garantis d'époque et authentiques, sauf avis contraire ou restriction dans la description.
Un certificat d'authenticité de l'objet reprenant la description publiée sur le site, l'époque, le prix de vente, accompagné d'une ou plusieurs photographies en couleurs est communiqué automatiquement pour tout objet dont le prix est supérieur à 130 euros. En dessous de ce prix chaque certificat est facturé 5 euros.
Seuls les objets vendus par mes soins font l'objet d'un certificat d'authenticité, je ne fais aucun rapport d'expertise pour les objets vendus par des tiers (confrères ou collectionneurs).
POUR TOUT ACHAT, PAIEMENT EN PLUSIEURS CHÈQUES POSSIBLE
bertrand.malvaux@wanadoo.fr 06 07 75 74 63
Un certificat d'authenticité de l'objet reprenant la description publiée sur le site, l'époque, le prix de vente, accompagné d'une ou plusieurs photographies en couleurs est communiqué automatiquement pour tout objet dont le prix est supérieur à 130 euros. En dessous de ce prix chaque certificat est facturé 5 euros.
Seuls les objets vendus par mes soins font l'objet d'un certificat d'authenticité, je ne fais aucun rapport d'expertise pour les objets vendus par des tiers (confrères ou collectionneurs).






