
Pique des Citoyennes de la « société des amis de la Constitution » dites « femmes clubistes »de Lyon, Révolution, avril 1792. COLLECTION PHILIPPE MISSILLIER, Étude Giquello, Drouot - salles 5-6, les 6 & 7 mars 2025
Vendu
COLLECTION PHILIPPE MISSILLIER
HAUTE ÉPOQUE – LIVRES – ARMES À FEU DU XVIIE SIÈCLE
ART CYNÉGÉTIQUE – PHALÉRISTIQUE
ARMES DES XVIIIE ET XIXE SIÈCLE – ART RUSSE
Vendredi 7 mars 2025 - 11h à 12h
AFRIQUE ET OCÉANIE – EXTRÊME-ORIENT
Vendredi 7 mars 2025 - 14h
ART ISLAMIQUE ET INDIEN
Drouot - salles 5-6
EXPOSITION
Mardi 4 mars de 11h à 18h
Mercredi 5 mars de 11h à 18h
Jeudi 6 mars de 11h à 12h
Téléphone pendant l’exposition + 33(0)1 48 00 20 05
GIQUELLO
Alexandre Giquello
Violette Stcherbatcheff
5, rue La Boétie - 75008 Paris
+33 (0)1 47 42 78 01 - info@giquello.net
o.v.v. agrément
n°2002 389
CONTACT
Claire Richon
+33(0)1 47 70 48 00
c.richon@giquello.net
EXPERT
Bertrand Malvaux, CNES
Lot n° 228 (de la vente)
Pique des Citoyennes de la « société des amis de la Constitution » dites « femmes clubistes »de Lyon, Révolution, avril 1792.
Fer en forme de lance, à deux pans, gravé sur une face « LES CITOYENNES DE LYON 1792 », à deux attelles.
L du fer 64 cm, L avec les attelles 66 cm, L totale 196 cm.
France.
Révolution.
Bon état, oxydation d’usage, bois postérieur.
700/1400
Note : Un exemplaire identique est conservé dans les collections du musée d’Histoire de Lyon, N° Inv. 48.81, récupéré par le citoyen Rosaz, témoin de l’époque, alors qu’il n’a que 16 ans.
Historique : Au delà d’un simple objet de collection, cette pique est un témoignage direct sur le rôle et de l’implication des femmes pendant la Révolution française et plus encore leur combat pour se voir reconnaître leur légitimité dans la vie politique.
Dans son Master 2 Histoire moderne et contemporaine parcours de la Renaissance aux révolutions Madame Juliette Mailhot a publié un historique très détaillé permettant de replacer cette pique dans le contexte historique « Les femmes en politique à Lyon (1789-1794) »(HAL Id: dumas-02121763 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02121763v1).
« En 1789 c’est avant tout la ville de Paris qui constitue le cœur de la révolution, elle est le
lieu des débats et bouleversements institutionnels. Cependant, l’organisation des États
généraux demande une mobilisation de toutes les régions… et l’on observe que les femmes sont peu mobilisées dans le cadre de cette préparation.
La lettre du roi Louis XVI est envoyée aux sénéchaux pour informer de la convocation des États généraux et de son règlement. Le 17 février 1789, c’est le Lieutenant général en la sénéchaussée de Lyon, Laurent Basset qui fixe le lieu et le jour de l’assemblée des trois ordres. Les cahiers de doléances doivent être rédigés et des élections doivent être organisées pour que soient élus des représentants. Les ordres sont convoqués, les participants doivent manifester leur volonté d’être présents ou représentés dans l’assemblée qui doit les réunir. Des assignations à comparaître à l’assemblée générale des trois ordres sont envoyées tout au long du mois de février 1789… aucune assignation ne semble être adressées à des femmes du Tiers état. Les assignations destinées au clergé séculier s’adresse aux curés des paroisses de Lyon et du plat pays. C’est dans les assignations envoyées au clergé régulier que l’on trouve des
femmes. Vingt et une assignations demandent à des religieuses de se rendre à l’assemblée des trois ordres, pour y assister, participer à la rédaction des cahiers et voter. En ce qui concerne l’ordre de la noblesse, des assignations sont également envoyées à dix-neuf femmes nobles possédant un fief. Les femmes du Tiers État ne sont jamais visibles.
Les possibilités d’actions politiques des femmes à Lyon sont donc très limitées. Des registres de sections sont rédigés et témoignent de la présence des femmes dans la vie urbaine.
Les femmes travaillent mais restent à une place bien définie. Elles ne sont pas présentes dans les structures de corporation. Peu de femmes sont auteurs de pétitions, et la plupart du temps elles souhaitent faire
valoir des droits, dans le cadre d’une séparation de biens. Un autre type d’archives rend compte de la présence des femmes dans la vie civique, comme le registre de la section de la paix (dans la rue Juiverie) de l’année 1793.
Le registre montre que les femmes tiennent un rôle dans les troubles de subsistances. Elles font partie des personnes impliquées dans des troubles à l’ordre public, lors desquels a été constaté le vol de pain dans un contexte de rumeur de disette ; elles sont également mobilisées pour pallier le manque d’effectifs dans les boulangeries.
L’administration lyonnaise est divisée en trois organes différents, des tensions et des différences d’opinion vont apparaître entre ces trois acteurs. Cela va conduire Lyon à entrer en conflit avec l’Assemblée nationale parisienne devenue la Convention. Le conflit politique favorise la hausse d’influence des sociétés et des clubs révolutionnaires, ainsi que l’intervention de la Convention. Dans ce contexte les femmes vont intervenir dans de nouveaux espaces et vont apparaître comme un ensemble relativement uni.
En 1791, la population est appauvrie, les prix des denrées souffrent de l’inflation. Les autorités de la ville sont divisées ce qui empêche la ville de retrouver un équilibre et de résoudre les problèmes de disette. Le 9 septembre 1792 la ville connaît de nombreux massacres, ce sont les « septembrisades lyonnaises ». C’est dans ce climat de grandes tensions, que quinze représentants sont élus, des partisans de la Gironde et parmi eux, Louis
Vitet. À ces derniers s’opposent les jacobins, qui soutiennent les Montagnards, et qui sont membres du club central. L’incertitude politique empêche les autorités de trouver une solution à la crise économique.
En juin 1793, deux cent sept députés des cantons et des sections de Rhône-et-Loire se proclament Commission populaire républicaine et de salut public, il s’agit d’un pouvoir insurrectionnel, la ville est déclarée en état de rébellion. Le 8 août 1793, la Convention envoie 10 000 hommes menés par le général Kellermann afin de mettre fin aux troubles qui affectent Lyon, le 9 octobre la ville capitule, et les jacobins reprennent le contrôle de la ville. Dès le 30 octobre, la Convention envoie JeanMarie Collot d’Herbois (député montagnard) et Joseph Fouché à Lyon, afin qu’ils mettent en place une commission temporaire de surveillance républicaine, indépendante des autorités locales, et aidée par une armée révolutionnaire.
Dans ce contexte, les femmes vont bénéficier d’un rôle particulier. Le besoin de secours à Lyon, une politisation du rôle des femmes. La ville souffre de sa grande pauvreté, le nombre de personnes ayant besoin de secours augmentent. Les femmes pourtant exclues des affaires politiques et publiques sont sollicitées pour participer à la lutte contre ces maux. Le 15 octobre 1793, des députés conventionnels, envoyés à Lyon, s’adressent aux citoyennes de Lyon pour qu’elles participent aux secours dont la ville a besoin. De nombreux enfants sont abandonnés et nécessitent d’être pris en charge. Les femmes, considérées comme citoyennes, sont mobilisées pour aider aux soins, et participent ainsi à la vie locale.
À Lyon, les proclamations conservées attestent que les femmes ne sont exclues ni des affaires de la ville, ni des questions révolutionnaires, elles sont appelées « citoyennes ». Ainsi, l’administration des secours donne aux femmes un rôle politisé.
Dans ce contexte, trois proclamations sur la gestion des secours offrent un rôle particulier aux femmes : celui d’intervenir pour offrir des secours aux indigents et aux enfants abandonnés
Les sociétés populaires ou les clubs sont des lieux d’apprentissage de la citoyenneté. Les clubs sont un lieu de discussion, les membres veulent également intervenir dans le domaine politique. Le club des jacobins de Lyon représente cette intensification des pratiques démocratiques, et une volonté de prôner l’intervention et la participation, notamment à travers l’acceptation de femmes. Mais les clubs ne peuvent délibérer publiquement, ils ne peuvent rédiger des pétitions collectives et chercher à avoir de l’influence sur les autorités locales. Cependant, à partir de 1791, les sociétés populaires commencent à avoir de l’influence sur les autorités administratives. La constitution de corps intermédiaires est vue comme une menace pour l’unité d’action de l’État. Les discussions se transforment en délibération, le club devient un rouage de l’administration de plus en plus influent.
La société des amis de la Constitution est formée par différentes sections de la ville. Les femmes sont rarement mentionnées dans les rapports de séances, cependant, ces mentions montrent que les femmes sont acceptées dans la société, mais également qu’elles y sont actives. Lors de la séance du 9 novembre 1791, elles sont mentionnées en tant que « femmes clubistes » qui doivent se présenter avec les cartes de club de leurs maris. Lors d’une séance du 4 mars 1792, les membres du club demandent que les « toutes les cytoyennes des ecolles » soient invitées, les citoyennes des écoles sont les institutrices des écoles de jeunes filles. Le 11 mars 1792, on apprend que les institutrices et leurs élèves ont été vivement remerciées et applaudies, pour avoir récité les droits de l’homme. La participation des femmes est aussi soulignée le 15 avril 1792, il est précisé que les citoyennes du club ont fabriqué des piques. Il est important de souligner la présence des femmes dans la société, en effet, accepter la présence des femmes ne va pas de soi. A titre d’exemple, la société des amis de la Constitution de la Croix Rousse, a exclu les « citoyens non actifs » lors de sa séance du 20 février 1791.
La correspondance du club des jacobins fait aussi état de la présence des femmes. Lors de la séance du 13 mai 1792, le comité central a arrêté que dans les clubs une « ligne de démarcation » devrait être effective entre les citoyennes clubistes et les autres membres du club. Cependant, le club des jacobins considère que cet arrêté est contraire à la loi de l’égalité. Les femmes sont membres à part entière.
Le 18 nivôse an II (7 janvier 1794), il est précisé que les tribunes sont faites pour accueillir les citoyens, ainsi que les citoyennes, mais qu’ils doivent s’y tenir décemment. La mixité de la sociabilité révolutionnaire est donc visible dans les principales sociétés populaires de Lyon. La radicalisation de la Révolution a donné un plus grand pouvoir aux clubs car ils ont contribué à l’action des institutions. Les clubs sont des lieux où les pratiques démocratiques se développent, et la présence des femmes le montre. À Lyon, le club des jacobins devient un des rouages de l’administration locale, il fait le lien entre les sections urbaines, et les comités de surveillances, dans le contexte de Terreur. C’est un club qui prend une valeur politique, la présence de citoyennes, au sein de ce dernier, en est d’autant plus importante. Les femmes ont donc un vrai rôle politique en participant à la vie du club, même si elles apparaissent essentiellement comme un ensemble. Elles sont désignées comme les citoyennes clubistes, aucune d’entre-elles n’est mise en avant. Ainsi, les bouleversements des administrations lyonnaises ont permis aux femmes d’accéder aux pratiques politiques, les femmes sont présentes dans un lieu mixte qui réunit la collectivité et entend valoriser le patriotisme, et la question de l’égalité. Les femmes montrent une prise de parole, une inscription administrative, une place dans l’espace révolutionnaire, elles font ainsi usage de pratiques révolutionnaires, et d’un rôle politique. Les femmes, dans le contexte des troubles politiques lyonnais, apparaissent comme un corps politique citoyen, qui a sa place dans l’espace public révolutionnaire et qui représente un enjeu pour les autorités de la ville.
HAUTE ÉPOQUE – LIVRES – ARMES À FEU DU XVIIE SIÈCLE
ART CYNÉGÉTIQUE – PHALÉRISTIQUE
ARMES DES XVIIIE ET XIXE SIÈCLE – ART RUSSE
Vendredi 7 mars 2025 - 11h à 12h
AFRIQUE ET OCÉANIE – EXTRÊME-ORIENT
Vendredi 7 mars 2025 - 14h
ART ISLAMIQUE ET INDIEN
Drouot - salles 5-6
EXPOSITION
Mardi 4 mars de 11h à 18h
Mercredi 5 mars de 11h à 18h
Jeudi 6 mars de 11h à 12h
Téléphone pendant l’exposition + 33(0)1 48 00 20 05
GIQUELLO
Alexandre Giquello
Violette Stcherbatcheff
5, rue La Boétie - 75008 Paris
+33 (0)1 47 42 78 01 - info@giquello.net
o.v.v. agrément
n°2002 389
CONTACT
Claire Richon
+33(0)1 47 70 48 00
c.richon@giquello.net
EXPERT
Bertrand Malvaux, CNES
Lot n° 228 (de la vente)
Pique des Citoyennes de la « société des amis de la Constitution » dites « femmes clubistes »de Lyon, Révolution, avril 1792.
Fer en forme de lance, à deux pans, gravé sur une face « LES CITOYENNES DE LYON 1792 », à deux attelles.
L du fer 64 cm, L avec les attelles 66 cm, L totale 196 cm.
France.
Révolution.
Bon état, oxydation d’usage, bois postérieur.
700/1400
Note : Un exemplaire identique est conservé dans les collections du musée d’Histoire de Lyon, N° Inv. 48.81, récupéré par le citoyen Rosaz, témoin de l’époque, alors qu’il n’a que 16 ans.
Historique : Au delà d’un simple objet de collection, cette pique est un témoignage direct sur le rôle et de l’implication des femmes pendant la Révolution française et plus encore leur combat pour se voir reconnaître leur légitimité dans la vie politique.
Dans son Master 2 Histoire moderne et contemporaine parcours de la Renaissance aux révolutions Madame Juliette Mailhot a publié un historique très détaillé permettant de replacer cette pique dans le contexte historique « Les femmes en politique à Lyon (1789-1794) »(HAL Id: dumas-02121763 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02121763v1).
« En 1789 c’est avant tout la ville de Paris qui constitue le cœur de la révolution, elle est le
lieu des débats et bouleversements institutionnels. Cependant, l’organisation des États
généraux demande une mobilisation de toutes les régions… et l’on observe que les femmes sont peu mobilisées dans le cadre de cette préparation.
La lettre du roi Louis XVI est envoyée aux sénéchaux pour informer de la convocation des États généraux et de son règlement. Le 17 février 1789, c’est le Lieutenant général en la sénéchaussée de Lyon, Laurent Basset qui fixe le lieu et le jour de l’assemblée des trois ordres. Les cahiers de doléances doivent être rédigés et des élections doivent être organisées pour que soient élus des représentants. Les ordres sont convoqués, les participants doivent manifester leur volonté d’être présents ou représentés dans l’assemblée qui doit les réunir. Des assignations à comparaître à l’assemblée générale des trois ordres sont envoyées tout au long du mois de février 1789… aucune assignation ne semble être adressées à des femmes du Tiers état. Les assignations destinées au clergé séculier s’adresse aux curés des paroisses de Lyon et du plat pays. C’est dans les assignations envoyées au clergé régulier que l’on trouve des
femmes. Vingt et une assignations demandent à des religieuses de se rendre à l’assemblée des trois ordres, pour y assister, participer à la rédaction des cahiers et voter. En ce qui concerne l’ordre de la noblesse, des assignations sont également envoyées à dix-neuf femmes nobles possédant un fief. Les femmes du Tiers État ne sont jamais visibles.
Les possibilités d’actions politiques des femmes à Lyon sont donc très limitées. Des registres de sections sont rédigés et témoignent de la présence des femmes dans la vie urbaine.
Les femmes travaillent mais restent à une place bien définie. Elles ne sont pas présentes dans les structures de corporation. Peu de femmes sont auteurs de pétitions, et la plupart du temps elles souhaitent faire
valoir des droits, dans le cadre d’une séparation de biens. Un autre type d’archives rend compte de la présence des femmes dans la vie civique, comme le registre de la section de la paix (dans la rue Juiverie) de l’année 1793.
Le registre montre que les femmes tiennent un rôle dans les troubles de subsistances. Elles font partie des personnes impliquées dans des troubles à l’ordre public, lors desquels a été constaté le vol de pain dans un contexte de rumeur de disette ; elles sont également mobilisées pour pallier le manque d’effectifs dans les boulangeries.
L’administration lyonnaise est divisée en trois organes différents, des tensions et des différences d’opinion vont apparaître entre ces trois acteurs. Cela va conduire Lyon à entrer en conflit avec l’Assemblée nationale parisienne devenue la Convention. Le conflit politique favorise la hausse d’influence des sociétés et des clubs révolutionnaires, ainsi que l’intervention de la Convention. Dans ce contexte les femmes vont intervenir dans de nouveaux espaces et vont apparaître comme un ensemble relativement uni.
En 1791, la population est appauvrie, les prix des denrées souffrent de l’inflation. Les autorités de la ville sont divisées ce qui empêche la ville de retrouver un équilibre et de résoudre les problèmes de disette. Le 9 septembre 1792 la ville connaît de nombreux massacres, ce sont les « septembrisades lyonnaises ». C’est dans ce climat de grandes tensions, que quinze représentants sont élus, des partisans de la Gironde et parmi eux, Louis
Vitet. À ces derniers s’opposent les jacobins, qui soutiennent les Montagnards, et qui sont membres du club central. L’incertitude politique empêche les autorités de trouver une solution à la crise économique.
En juin 1793, deux cent sept députés des cantons et des sections de Rhône-et-Loire se proclament Commission populaire républicaine et de salut public, il s’agit d’un pouvoir insurrectionnel, la ville est déclarée en état de rébellion. Le 8 août 1793, la Convention envoie 10 000 hommes menés par le général Kellermann afin de mettre fin aux troubles qui affectent Lyon, le 9 octobre la ville capitule, et les jacobins reprennent le contrôle de la ville. Dès le 30 octobre, la Convention envoie JeanMarie Collot d’Herbois (député montagnard) et Joseph Fouché à Lyon, afin qu’ils mettent en place une commission temporaire de surveillance républicaine, indépendante des autorités locales, et aidée par une armée révolutionnaire.
Dans ce contexte, les femmes vont bénéficier d’un rôle particulier. Le besoin de secours à Lyon, une politisation du rôle des femmes. La ville souffre de sa grande pauvreté, le nombre de personnes ayant besoin de secours augmentent. Les femmes pourtant exclues des affaires politiques et publiques sont sollicitées pour participer à la lutte contre ces maux. Le 15 octobre 1793, des députés conventionnels, envoyés à Lyon, s’adressent aux citoyennes de Lyon pour qu’elles participent aux secours dont la ville a besoin. De nombreux enfants sont abandonnés et nécessitent d’être pris en charge. Les femmes, considérées comme citoyennes, sont mobilisées pour aider aux soins, et participent ainsi à la vie locale.
À Lyon, les proclamations conservées attestent que les femmes ne sont exclues ni des affaires de la ville, ni des questions révolutionnaires, elles sont appelées « citoyennes ». Ainsi, l’administration des secours donne aux femmes un rôle politisé.
Dans ce contexte, trois proclamations sur la gestion des secours offrent un rôle particulier aux femmes : celui d’intervenir pour offrir des secours aux indigents et aux enfants abandonnés
Les sociétés populaires ou les clubs sont des lieux d’apprentissage de la citoyenneté. Les clubs sont un lieu de discussion, les membres veulent également intervenir dans le domaine politique. Le club des jacobins de Lyon représente cette intensification des pratiques démocratiques, et une volonté de prôner l’intervention et la participation, notamment à travers l’acceptation de femmes. Mais les clubs ne peuvent délibérer publiquement, ils ne peuvent rédiger des pétitions collectives et chercher à avoir de l’influence sur les autorités locales. Cependant, à partir de 1791, les sociétés populaires commencent à avoir de l’influence sur les autorités administratives. La constitution de corps intermédiaires est vue comme une menace pour l’unité d’action de l’État. Les discussions se transforment en délibération, le club devient un rouage de l’administration de plus en plus influent.
La société des amis de la Constitution est formée par différentes sections de la ville. Les femmes sont rarement mentionnées dans les rapports de séances, cependant, ces mentions montrent que les femmes sont acceptées dans la société, mais également qu’elles y sont actives. Lors de la séance du 9 novembre 1791, elles sont mentionnées en tant que « femmes clubistes » qui doivent se présenter avec les cartes de club de leurs maris. Lors d’une séance du 4 mars 1792, les membres du club demandent que les « toutes les cytoyennes des ecolles » soient invitées, les citoyennes des écoles sont les institutrices des écoles de jeunes filles. Le 11 mars 1792, on apprend que les institutrices et leurs élèves ont été vivement remerciées et applaudies, pour avoir récité les droits de l’homme. La participation des femmes est aussi soulignée le 15 avril 1792, il est précisé que les citoyennes du club ont fabriqué des piques. Il est important de souligner la présence des femmes dans la société, en effet, accepter la présence des femmes ne va pas de soi. A titre d’exemple, la société des amis de la Constitution de la Croix Rousse, a exclu les « citoyens non actifs » lors de sa séance du 20 février 1791.
La correspondance du club des jacobins fait aussi état de la présence des femmes. Lors de la séance du 13 mai 1792, le comité central a arrêté que dans les clubs une « ligne de démarcation » devrait être effective entre les citoyennes clubistes et les autres membres du club. Cependant, le club des jacobins considère que cet arrêté est contraire à la loi de l’égalité. Les femmes sont membres à part entière.
Le 18 nivôse an II (7 janvier 1794), il est précisé que les tribunes sont faites pour accueillir les citoyens, ainsi que les citoyennes, mais qu’ils doivent s’y tenir décemment. La mixité de la sociabilité révolutionnaire est donc visible dans les principales sociétés populaires de Lyon. La radicalisation de la Révolution a donné un plus grand pouvoir aux clubs car ils ont contribué à l’action des institutions. Les clubs sont des lieux où les pratiques démocratiques se développent, et la présence des femmes le montre. À Lyon, le club des jacobins devient un des rouages de l’administration locale, il fait le lien entre les sections urbaines, et les comités de surveillances, dans le contexte de Terreur. C’est un club qui prend une valeur politique, la présence de citoyennes, au sein de ce dernier, en est d’autant plus importante. Les femmes ont donc un vrai rôle politique en participant à la vie du club, même si elles apparaissent essentiellement comme un ensemble. Elles sont désignées comme les citoyennes clubistes, aucune d’entre-elles n’est mise en avant. Ainsi, les bouleversements des administrations lyonnaises ont permis aux femmes d’accéder aux pratiques politiques, les femmes sont présentes dans un lieu mixte qui réunit la collectivité et entend valoriser le patriotisme, et la question de l’égalité. Les femmes montrent une prise de parole, une inscription administrative, une place dans l’espace révolutionnaire, elles font ainsi usage de pratiques révolutionnaires, et d’un rôle politique. Les femmes, dans le contexte des troubles politiques lyonnais, apparaissent comme un corps politique citoyen, qui a sa place dans l’espace public révolutionnaire et qui représente un enjeu pour les autorités de la ville.
Référence :
Étude Giquello, Drouot - salles 5-6, les 6 & 7 mars 2025
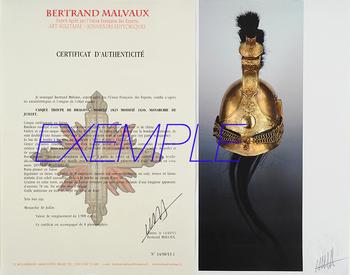
Prochaine mise à jour vendredi 4 avril à 13H30
POUR TOUT ACHAT, PAIEMENT EN PLUSIEURS CHÈQUES POSSIBLE
bertrand.malvaux@wanadoo.fr 06 07 75 74 63
FRAIS DE PORT
Les frais de port ne sont calculés qu'une seule fois par commande pour un ou plusieurs objets, les envois sont tous recommandés, car c'est le seul moyen d'avoir une preuve de l'envoi et de la réception.
Pour les colis dont la valeur ne peut être assurée par la Poste, les envois sont confiés à la société DHL ou Fedex avec valeur réelle assurée, le service est de qualité mais le coût est plus élevé.
DROIT DE RETOUR
Les objets peuvent être retournés dans un délai de 8 jours après leur réception. Il faut les retourner en recommandé aux frais de l'expéditeur, dans leur emballage d'origine, et dans leur état d'origine,
AUTHENTICITÉ
La sélection des objets proposés sur ce site me permet de garantir l'authenticité de chacune des pièces qui y sont décrites, tous les objets proposés sont garantis d'époque et authentiques, sauf avis contraire ou restriction dans la description.
Un certificat d'authenticité de l'objet reprenant la description publiée sur le site, l'époque, le prix de vente, accompagné d'une ou plusieurs photographies en couleurs est communiqué automatiquement pour tout objet dont le prix est supérieur à 130 euros. En dessous de ce prix chaque certificat est facturé 5 euros.
Seuls les objets vendus par mes soins font l'objet d'un certificat d'authenticité, je ne fais aucun rapport d'expertise pour les objets vendus par des tiers (confrères ou collectionneurs).
POUR TOUT ACHAT, PAIEMENT EN PLUSIEURS CHÈQUES POSSIBLE
bertrand.malvaux@wanadoo.fr 06 07 75 74 63
Un certificat d'authenticité de l'objet reprenant la description publiée sur le site, l'époque, le prix de vente, accompagné d'une ou plusieurs photographies en couleurs est communiqué automatiquement pour tout objet dont le prix est supérieur à 130 euros. En dessous de ce prix chaque certificat est facturé 5 euros.
Seuls les objets vendus par mes soins font l'objet d'un certificat d'authenticité, je ne fais aucun rapport d'expertise pour les objets vendus par des tiers (confrères ou collectionneurs).
